LGV Bordeaux-Toulouse : la grande vitesse au bout d’un long chemin
Written by Mattéo GUILLEMARD
40 ans après la première évocation de ce grand projet, la Ligne à Grande Vitesse (LGV) entre Bordeaux et Toulouse a enfin commencé à sortir de terre en mai dernier. Cette nouvelle infrastructure de 222 km passant par Agen et Montauban permettra de relier Paris et la ville rose en seulement trois heures et dix minutes, contre au minimum quatre heures et vingt-trois minutes actuellement. Cette nouvelle voie ferrée, construite en parallèle de la ligne déjà existante, a connu de nombreuses difficultés et résistances à la fois politiques, économiques et environnementales malgré une utilité reconnue étant donné son futur impact socio-économique sur une multitude d’aires urbaines.
Une histoire tumultueuse
La LGV Paris-Lyon ouvre en 1981 et connaît un grand succès à travers un fort report modal de l’avion et de la voiture au profit du train. Peu après naît l’idée d’une LGV reliant Paris et Toulouse, déjà pensée pour traverser Bordeaux du fait de la future LGV Paris-Tours déjà entamée (mise en service en 1989), de l’importance des villes du Sud-Ouest et de la difficile traversée du Limousin. Cependant, aucune échéance ou investissement n’est encore discuté. Il faudra attendre 2002 pour que des premières études soient lancées concernant cette LGV en ces deux composantes : Tours-Bordeaux et Bordeaux-Toulouse.
En 2006, le bien-fondé du projet est confirmé, son tracé et sa desserte finalisés mais différentes interrogations subsistent, notamment concernant sa compatibilité avec une future ligne Bordeaux-Espagne et un éventuel prolongement vers Narbonne, ralentissant une nouvelle fois le projet. Ces questions sont levées en 2007, les décideurs publics espèrent voir cette nouvelle ligne en opération dès 2020, d’autant plus avec la loi Grenelle de 2009, dans laquelle le gouvernement affirme son intention d’investir massivement dans les LGV.
Cependant, au même moment, la crise de la dette fragilise le budget de l’État qui remet alors en question ces grands projets très coûteux. C’est dans ce contexte houleux qu’est lancée l’enquête d’utilité publique en 2011 aboutissant à un avis défavorable en 2015 de l’ensemble du Grand Projet Ferroviaire du Sud-Ouest (GPSO) : la rentabilité économique est contestée et l’impact sur la biodiversité est jugé trop peu évalué. N’étant qu’un avis, le Conseil d’État valide l’utilité publique du projet en 2016 mais fait face à de nombreux recours et résistances mises en place pour ralentir les procédures. Le tribunal administratif de Bordeaux arrive alors à annuler le décret d’utilité publique en 2017.
On voit alors un désengagement complet des projets de LGV au profit d’investissements dans les transports domicile-travail, jugés beaucoup plus pertinents.
Le projet n’est pour autant pas annulé mais il faudra attendre 2021 pour que le Conseil d’État valide en cassation l’utilité publique de la LGV Bordeaux-Toulouse, rendant impossible les recours à cette décision. C’est en 2022 que le financement du projet est acté : 14 milliards d’euros provenant d’un emprunt massif combiné à d’importantes sommes fournies par les collectivités, l’État, l’Union Européenne et différents prélèvements obligatoires demandés aux propriétaires d’immeubles de bureau bénéficiant de cette ligne. Les travaux commencent alors en mai 2024 pour une livraison prévue en 2032.

Un impact socio-économique fort
Rappelons que l’intérêt premier d’une LGV est la décarbonation du fait de son fonctionnement à l’électricité produite par le nucléaire. De nombreux transferts modaux sont attendus, notamment des voyageurs empruntant l’avion et la voiture pour se rendre à Toulouse. Les personnes voyageant entre Toulouse et Bordeaux auront ainsi un moyen de transport fiable, rapide et desservant directement les deux centres-villes, réduisant ainsi la congestion automobile au sein des agglomérations. C’est d’ailleurs exactement ce qui s’est passé à Bordeaux : très rapidement, la LGV a mis fin à la liaison aérienne. Notons cependant que, selon le président de la Chambre de Commerce et d’Industrie de Toulouse, l’impact sur le secteur aérien restera limité (une baisse d’environ 30 %) car Toulouse demeurera à plus de trois heures de train de Paris, ce qui reste conséquent.
Dans ce cadre de réduction de l’impact carbone lié aux déplacements, cette LGV ouvrira également la voie à une meilleure offre de TER. En effet, les TGV passant désormais sur la nouvelle LGV, la voie ferrée préexistante pourra être en partie ré-utilisée pour accroître l’offre de trains régionaux. La région Nouvelle-Aquitaine prévoit de doubler la fréquence de ces derniers quand la région Occitanie a pour objectif d’aller jusqu’à quasiment quatre fois plus de passages. Un bond dans l’utilisation du TER avait été observé lors de l’arrivée de la LGV à Bordeaux en 2017. Mis en avant par le président de la région Nouvelle-Aquitaine, un autre impact moins connu est une expansion du fret ferroviaire via cette moindre utilisation de la ligne classique entre Toulouse et Bordeaux. Cela diminuerait alors le nombre de camions sur les routes entre ces deux métropoles. Sur ces trajets, la part du fret ferroviaire devrait atteindre les 18 %, contre 3 % aujourd’hui.
Une forte augmentation de voyageurs transitant par Toulouse-Matabiau est attendue, contraignant la ville à repenser entièrement ce pôle multimodal. Les transports urbains (métro, bus et TER) vont être renforcés, les parking relais agrandis et la gare complètement métamorphosée avec, par exemple, un deuxième niveau. Le but est de repenser le quartier pour en faire un pôle attractif où toutes les connexions se font aisément entre les différents moyens de transports, comprenant également la nouvelle ligne de métro C. Cette rapide liaison entre Toulouse et Bordeaux sera possiblement la source de synergies entre les deux villes couplées à un surcroît de compétitivité de Toulouse avec l’installation de nouvelles entreprises et donc, la création d’emplois.
Petit à petit, Toulouse gommera son image d’enclavement relatif.
Cette LGV permettra une meilleure accessibilité à la région Occitanie, qui est une des régions où la population a augmenté le plus ces dix dernières années.
Toulouse est aujourd’hui la quatrième ville française, en passe de devenir la troisième si les tendances se confirment.
De nombreuses contestations
Paradoxalement, à l’instar des arguments écologiques en faveur de la LGV, c’est sur ce sujet que les détracteurs du projet lui opposent des critiques. En effet, de nombreuses associations d’activistes écologiques accompagnés par différents élus de Nouvelle-Aquitaine, comme le maire de Bordeaux, soulignent les conséquences environnementales néfastes de ce projet.
La construction de cette nouvelle infrastructure détruira de nombreux espaces naturels comprenant des forêts et des zones humides, parfois protégés par le label Natura 2000.
Néanmoins, la société du GPSO rassure : si l’emprise de la LGV couvre 4 830 hectares, moins de 700 d’entre eux comprennent des milieux naturels sensibles, dont 250 hectares de zones humides. Ainsi, 41 hectares Natura 2000 seront en effet artificialisés. Notons que des mesures compensatoires seront mises en œuvre et sont partie constituante du projet : entre 2 000 et 3 000 hectares seront restaurés afin de laisser la nature s’y exprimer.
Les opposants dénoncent également un impact carbone massif dû à la construction de cette ligne : environ 4,5 millions de tonnes équivalent CO2. Selon eux, le projet serait alors non rentable en carbone. Concernant ce point, l’enquête d’utilité publique avait jugé que la compensation s’opérerait en moins de 10 ans du fait des reports modaux.
Le coût pharaonique du projet est souvent décrié : plus de 14 milliards d’euros. Le gain de temps est alors jugé marginal par rapport à l’investissement avancé. Les détracteurs préfèrent proposer une solution alternative : moderniser l’ancienne ligne et favoriser les trains du quotidien. Cette modernisation de la ligne existante aurait été moins coûteuse, mais le gain de temps entre Toulouse et Bordeaux aurait été moindre.

Conclusion
Malgré son intérêt économique et écologique, la LGV Bordeaux-Toulouse a connu de nombreux freins à sa mise en œuvre, ses effets bénéfiques étant régulièrement remis en question. La confirmation du projet n’a pas empêché la suite des péripéties : en 2022, l’Union Européenne a annoncé son désengagement partiel du financement, laissant en suspens les 20 % de subventions initialement espérés. Cet aspect reste l’un des principaux leviers des opposants, qui continuent de se mobiliser pour un investissement alternatif. L’histoire de ce projet est donc loin d’être achevée, et seuls les développements à venir nous diront si le pari d’un Paris-Toulouse en un peu plus de trois heures se concrétisera d’ici huit ans.
More Articles
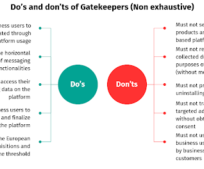
The practical application, potential effectiveness and limits of the Digital Markets Act
By: Besseghir Yassine
On the 1st of November 2022 the Digital Market Act entered into force and become applicable on 2 May 2023. As it is stated on the European Commission webpage, “The Digital Markets Act is the EU’s law to make the markets in the digital sector fairer and more contestable”....

At a Crossroads: Europe's Weaknesses and Future in the Draghi Report
By: Du Breil Lucie
On September 9th, Mario Draghi, former president of the European Central Bank, derived its findings about the economic future of “The Old Continent”, like a ticking bomb. It presents a sharp analysis of Europe’s economic competitiveness, highlighting the strengths and the incoming challenges ...
Mental and intellectual disabilities on the labor market
By: Desbabel Chloé and Doville Léopold
The 28th European Week for the Employment of People with Disabilities will take place from November 18 to 24, 2024. Between 20% and 30% of people across Europe report having some form of disability that impacts their daily activities...
The Fed’s Finest Hour
By: E.Flandin, V.Belleux and P.Rossignol
The central bank, often unknown to the general public, plays a crucial role in regulating and stabilizing the economy of a country, or a continent. Its main objectives are to regulate inflation and help the economy operate “smoothly” using various levers.These tools can be used for economic stimulus, such as setting key interest rates, which determine lending conditions for banks...

Why Are Monopolies Hard to Dismantle in the United States?
By: Echerfaoui Laila
This year, Professor Michael D.Whinston was awarded the Jean-Jacques Laffont Prize for his significant work on antitrust laws and his involvement in the Google monopoly case. After going through his main publications, news reports about him, and videos on the Google case, I started wondering: why are monopolies so hard to dismantle in the U.S. ...

